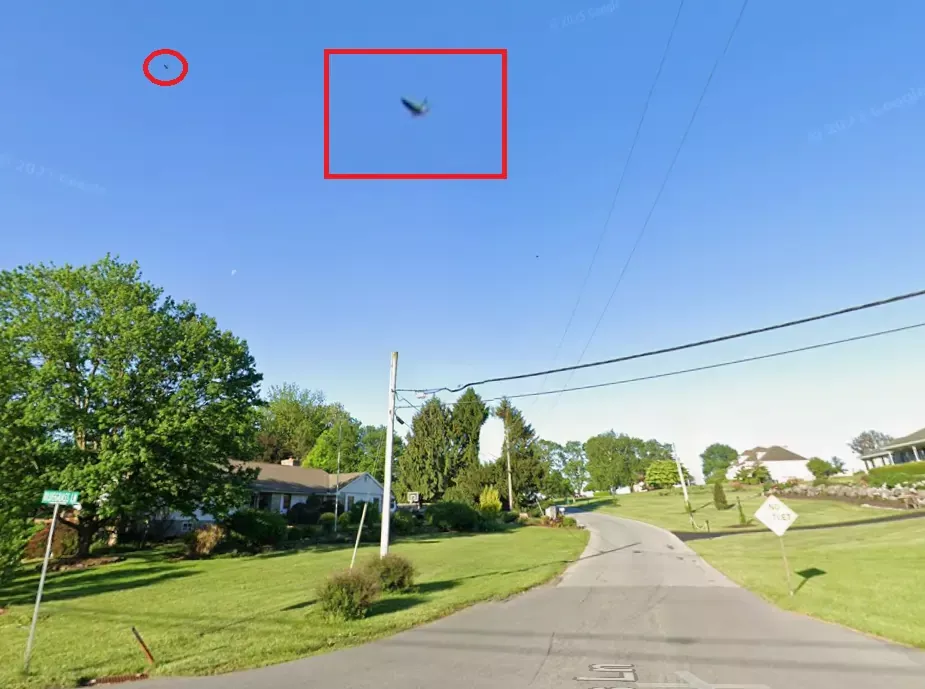Les récits de réincarnation liés à l’enfance continuent d’alimenter un champ de recherche aussi discret que troublant. Au Japon, le professeur Ohkado Masayuki, spécialiste en linguistique, s’est fait connaître pour ses travaux consacrés à l’étude de témoignages d’enfants semblant évoquer des souvenirs appartenant à une vie antérieure. Parmi les nombreux cas qu’il a documentés, l’un d’eux, étudié à partir de 2015, demeure particulièrement marquant.
L’histoire débute au début des années 1990 avec la disparition d’une femme prénommée Midori, mère de trois enfants. Son décès en 1993 laisse une famille endeuillée, profondément attachée à sa mémoire. L’année suivante, sa fille Atsuko se marie, quitte le foyer familial et fonde à son tour une famille. En 1996 naît une petite fille, Tae.
Très tôt, Atsuko est frappée par un sentiment étrange : quelque chose, dans le comportement et l’expression de son enfant, lui rappelle intensément sa propre mère. Une impression diffuse, mais persistante, qui va prendre une tournure inattendue lorsque Tae n’a que deux ans. Ce jour-là, Atsuko montre à sa fille une photographie de Midori en lui disant : « C’est ta grand-mère ». La réponse de l’enfant est immédiate, et déconcertante : « Moi ».
Ce moment marque le début d’une série d’événements troublants. La famille, pratiquante du zen, une tradition spirituelle dans laquelle la réincarnation occupe une place importante, ne rejette pas d’emblée cette déclaration. Sans chercher à l’interpréter de manière sensationnaliste, Atsuko observe néanmoins sa fille avec une attention nouvelle.
Un an plus tard, alors que Tae est âgée de trois ans, Atsuko traverse une période de profonde mélancolie liée au souvenir de sa mère disparue. Un jour, alors qu’elles se promènent ensemble, la fillette prononce spontanément une phrase qui bouleverse sa mère : « Je dois lui remonter le moral ». Pour Atsuko, ce simple propos agit comme un choc émotionnel. Elle confiera plus tard avoir eu l’impression, fugace mais puissante, que Midori était revenue auprès d’elle.
Intrigué par ces témoignages, le professeur Masayuki mène une série d’entretiens approfondis, inscrivant ce cas dans ses recherches sur les récits spontanés d’enfants évoquant une autre existence. Comme dans d’autres affaires similaires étudiées à travers le monde, ces souvenirs semblent s’estomper avec l’âge.
Lorsque Masayuki retrouve Tae plusieurs années plus tard, à la fin de son adolescence, la jeune femme ne conserve aucun souvenir de Midori, ni de propos liés à une éventuelle vie antérieure. Les paroles prononcées dans l’enfance ont disparu, comme effacées par le temps.
Pour le chercheur, ce silence tardif n’invalide pas nécessairement l’expérience. Il souligne que de nombreux cas de ce type présentent une caractéristique commune : des souvenirs précoces, souvent très vifs, qui s’évanouissent à mesure que l’enfant grandit et construit sa propre identité.
Entre foi, psychologie et mystère, l’histoire de Tae continue de soulever des questions fondamentales sur la mémoire, la conscience et la frontière incertaine entre l’expérience individuelle et l’héritage invisible des générations passées. Un terrain de recherche où, pour l’instant, les certitudes restent aussi rares que les témoignages sont fascinants.
Gemini, CC0,